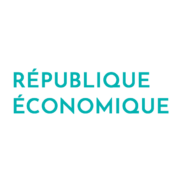Un jour ou l’autre, nous tombons tous dans le piège de la péréquation, soit en nous faisant convaincre que le Québec indépendant ne pourrait vivre sans, soit en perdant notre temps avec des opposants qui ne cherchent qu’à empêcher le Québec libre, peu importe la manière.
Avant, c’était la dette. Maintenant que notre dette nette est inférieure à celle de l’Ontario (42,4 % de notre PIB en mars 2021 vs 43,1 % selon la Chaire en fiscalité et en finances publiques), est-ce que les partisans du Canada font leur mea culpa et déclarent que l’indépendance est réalisable? Évidemment non, car ils cherchent n’importe quel moyen pour nous faire peur. Ça ne date pas d’hier, pensons au coup de la Brink’s en avril 1970.
Revenons à l’une des peurs les plus populaires en ce moment « le Québec indépendant, ne recevant plus de péréquation, ne serait pas économiquement viable ». En partant, cette prémisse est trompeuse, car la péréquation n’est pas une étude sur l’économie du Québec indépendant. La prochaine fois qu’on tentera de vous faire tomber dans le panneau de la péréquation, je vous suggère de répondre du tac au tac : sur quelle étude économique vous basez-vous? Une telle étude doit tenir compte de l’ensemble des taxes, tarifs et impôts récoltés sur le territoire québécois, et ensuite elle doit estimer l’ensemble des dépenses du nouvel État indépendant. Elle doit faire des hypothèses, car certaines dépenses canadiennes n’existeront plus, par exemple les millions pour la monarchie britannique ou les milliards pour le pipeline Trans Mountain. Il faut également calculer les économies réalisées avec la fin des dédoublements de ministères. Il faut aussi considérer de nouvelles dépenses, par exemple les ambassades québécoises devraient nous coûter plus cher qu’en ce moment, car nous payons le cinquième des ambassades canadiennes, mais nous payerons 100 % des québécoises, qui elles ne devraient pas être cinq fois plus petites.
Ce calcul vient d’être fait pour une énième fois, et à nouveau le résultat démontre un surplus pour le budget de l’an 1 du Québec indépendant. On pourrait même aller plus loin dans nos hypothèses, car ce calcul comptable est statique, il ne tient pas compte d’éléments propices à favoriser l’économie québécoise : une politique économique cohérente basée sur nos intérêts premiers, et non ceux de la nation voisine, l’effet multiplicateur des investissements qui en découlent, le contrôle d’une devise québécoise avec une politique monétaire favorisant nos exportations manufacturières, etc. Ces hypothèses devraient minimalement être mises de l’avant quand on nous dresse la liste de tous les marasmes économiques qui nous attendent, marasmes qui miraculeusement n’ont pas eu lieu lors des indépendances pacifiques du siècle dernier en Occident.
En conclusion, je considère que pour défaire nos peurs, ça prend du courage et des connaissances. J’ai la conviction que plus nous serons nombreux à risquer nos carrières en prenant la parole publiquement pour l’indépendance, plus grandes seront nos chances d’un jour vivre au Québec libre.
Jean-Michel Goulet, économiste M. Sc.
23 novembre 2024